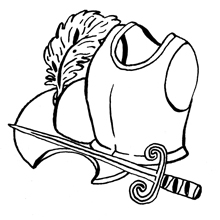De Miguel de Cervantès
Adaptation et mise en scène Jérémie Le Louët
Alonso Quijano a lu trop de romans de chevalerie. Ils lui ont tourné la tête. Le voilà qui change de nom et se fait chevalier.
Monté sur un canasson baptisé Rossinante et accompagné de son écuyer Sancho Panza, il bat la campagne pour défendre les opprimés, pourfendre les oppresseurs et se couvrir de gloire. Mais l’improbable justicier confond fantasme et réalité. Il prend les auberges pour des châteaux, les moulins à vent pour de cruels géants et les troupeaux de brebis pour de féroces armées. Parce que, chez lui, la volonté de croire crée la vérité. Si Jérémie Le Louët aime la démesure des personnages de Cervantès, ballotés entre tragédie classique et canular, il aime aussi l’ambiguïté du récit qui alterne entre le vrai et le faux, dont Cervantès s’est joué en critiquant lui-même l’histoire qu’il était en train d’écrire. Une mise en abyme constante que relaie le plateau jonché de matériels divers bien réels, comme sur un tournage de fiction.
Reportage d’Arte TV :
Adaptation et mise en scène Jérémie Le Louët
Avec
Sancho Panza Julien Buchy
Le Duc Anthony Courret
Le prêtre Jonathan Frajenberg
Don Quichotte Jérémie Le Louët
Le fils Pierre-Antoine Billon
La Duchesse Dominique Massat
Collaboration artistique Noémie Guedj
Scénographie Blandine Vieillot
Lumières Thomas Chrétien
Costumes Barbara Gassier
Vidéo Thomas Chrétien, Simon Denis et Jérémie Le Louët
Son Simon Denis
Il y a douze ans, j’ai réuni un groupe de comédiens de ma génération avec lequel est née la Compagnie des Dramaticules. Ensemble, nous avons créé une grammaire de jeu. Travailler en troupe nous a permis de créer un répertoire de spectacles toujours vivants, enrichis par les années et les créations nouvelles.
J’aime que cohabitent dans un même spectacle la tradition et l’expérimentation, la grandiloquence et le réalisme le plus trivial, la moquerie satirique et l’hommage vibrant, la tragédie classique et le canular. Mes choix de répertoire et de création sont toujours guidés par cette envie de décloisonner les genres, de bousculer les codes, de contester la notion de format. Parce que son héros est un insoumis, Don Quichotte cristallise ce rapport au théâtre, ce rapport au monde. C’est une satire des romans de chevalerie mais c’est aussi, comme l’a dit Borges, « un secret adieu nostalgique » au roman de chevalerie. Cette ambigüité entre sacralisation et désacralisation soulève la question de la légitimité des classiques, de la foi dans les chefs-d’œuvre : quelle est la part d’authenticité et d’imposture dans l’acte créateur ? Quelle est la frontière entre le réel et le fantasme, entre le souvenir et le rêve ? Et Don Quichotte semble répondre : tout ce qui est beau est vrai ! La volonté de croire crée la vérité.
L’histoire en quelques mots : Alonso Quijano a lu trop de romans de chevalerie. Il en devient fiévreux et fou. Il change de nom, décide de se faire chevalier errant et part sur les routes, accompagné de son écuyer Sancho Panza, cherchant la gloire, défendant les opprimés, pourfendant les oppresseurs, luttant contre les injustices de ce monde. Et dans cette quête d’idéal, il confond théâtre et réalité, met sur un pied d’égalité les livres saints et profanes, et devient, jusqu’à la transe, un fanatique de la fiction chevaleresque.
Don Quichotte a une place particulière dans l’inconscient collectif. C’est une œuvre que tout le monde connaît mais dont les lecteurs sont finalement plutôt rares. On en connaît les deux principaux personnages, Alonso Quijano et Sancho Panza, l’épisode des moulins à vents, l’amour du héros pour sa Dulcinée, son cheval Rossinante, mais guère plus. Et cela, à vrai dire, n’a pas tellement d’importance. Cervantès a créé un type, un personnage si exceptionnel qu’il a rendu le détail de ses aventures presque secondaires.
Il y a dans Don Quichotte une distanciation entre l’auteur (Cervantès) et le narrateur (l’historien Sidi Hamet Ben Engeli). Cette distanciation permet à Cervantès d’être à la fois le défenseur et le critique du roman qu’il est en train d’écrire. Cette mise en abyme constante, ce jeu avec le lecteur est ce qui me fascine le plus. L’histoire qui nous est contée est annoncée comme véridique mais son conteur lui-même est un personnage de fiction. Cervantès va plus loin : il multiplie les allers-retours entre fiction principale et fictions secondaires, et fait faire du théâtre à ses personnages. Tous ces renversements, ces imbriquements et ces jeux de miroirs, ne peuvent être réduits à des prouesses stylistiques. Ce rapport singulier à la fiction fait de Don Quichotte le premier roman moderne : un roman qui scrute le roman. Cette spécificité rend le travail de l’adaptation pour la scène indissociable du travail au plateau avec les acteurs et les techniciens.
Au théâtre, il n’y a de réel que la représentation, avec ses acteurs jouant le spectacle et ses spectateurs y assistant : je crois en la vérité de la représentation théâtrale mais non en une fiction strictement réaliste. En revanche, il n’y a pas de lieu plus propice que le théâtre pour confronter la fiction et la réalité. Shakespeare, Calderón, Hugo, Pirandello, Brecht : tous ont compris que la force du théâtre se trouve précisément dans ces instants de trouble où la fiction et la réalité deviennent une seule et même chose, où les personnages sont des acteurs qui jouent des personnages, devant un public qui joue le jeu de la représentation.
J’imagine la scène jonchée de matériels divers (caméras, écrans, rails, projecteurs sur pieds, grue, régie, micros, toiles peintes, un cheval surdimensionné, armures…). Le choix d’un plateau de tournage comme scénographie doit créer d’emblée une superposition entre la fiction (l’histoire) et la réalité (la représentation). Le spectacle conte l’histoire d’un homme qui décide de lutter contre la médiocrité du monde pour la transformer en une épopée fantasmagorique. C’est, je crois, la quête de tout artiste et de tout spectateur.
Jérémie Le Louët
Jérémie Le Louët
Il effectue sa formation théâtrale dans les classes de Stéphane Auvray-Nauroy et de Michel Fau. Entre 1999 et 2002, il joue notamment dans Elle de Jean Genet au Théâtre le Colombier (mise en scène Valéry Warnotte), Marion Delorme et Le roi s’amuse de Victor Hugo au Théâtre du Marais (mise en scène Julien Kosellek et Stéphane Auvray-Nauroy), Occupe-toi d’Amélie de Georges Feydeau au Théâtre le Trianon (mise en scène Caroline Carpentier).
En octobre 2002, il réunit un groupe de comédiens de sa génération avec lequel naît la Compagnie des Dramaticules. Dès lors, il interroge les notions d’interprétation et de représentation en portant un regard critique sur le jeu. En février 2003, il crée Macbett de Ionesco au Théâtre le Proscenium. Il y pose les bases de son travail sur le tempo, la dynamique et le phrasé. En octobre 2004, il illustre, par un prologue, La Symphonie Pastorale de Beethoven interprétée par l’Orchestre de Paris, sous la direction de Marek Janowski, au Théâtre Mogador. En 2005, il présente une recréation de Macbett d’Eugène Ionesco au Théâtre 13 et y interprète le rôle de Duncan. Il joue ensuite dans Rated X, création d’Angelo Pavia présentée à la MC93 à Bobigny en septembre 2006. En décembre 2007, il met en scène Hot House d’Harold Pinter, spectacle dans lequel il interprète le rôle de Lush. En janvier 2009, il met en scène Un Pinocchio de moins ! d’après Carlo Collodi ; il interprète les rôles de Geppetto, Mangefeu, le Grillon-qui-parle. Il crée Le Horla de Guy de Maupassant au Festival d’Avignon 2010. Il interprète Hérode dans Salomé d’Oscar Wilde qu’il met en scène en janvier 2011. Il met en scène Richard III de William Shakespeare au Théâtre 13 / Seine à l’automne 2012, où il interprète le rôle-titre. Il crée Affreux, bêtes et pédants au Théâtre de Châtillon en janvier 2014. Il met en scène Ubu roi d’après Alfred Jarry au Théâtre de Châtillon en novembre 2014.
La Compagnie des Dramaticules est l’invitée de l’édition 2016 du Festival de Grignan. Jérémie Le Louët et son équipe y créeront Don Quichotte d’après Miguel de Cervantès.
Les histoires et le ambiances se succèdent à un rythme fou. La troupe passe son temps à construire les vérités du roman et à les retourner, fidèle au héros de Cervantès, entre la fronde et le rêve.
Lionel Jullien – Arte Info
Un spectacle hors norme, qui fait jouer aussi le public. Un moment inoubliable.
Aurélia Bloch – France 2, Télématin
En jouant à fond sur le divertissement mais aussi sur le théâtre en construction, le metteur en scène réussit là où Orson Welles et Terry Gilliam ont échoué dans l’adaptation de ce roman épique. Et c’est un exploit.
Stéphane Capron – France Inter – Chronique à écouter ici
Celui qui a déjà monté Ionesco, Jarry et Shakespeare sait casser la théâtralité tout en la célébrant, jouer en déjouant. Sa rage à faire entendre la parole radicale de Cervantès, sa défence des marginaux et notre réel besoin de chevalerie aujourd’hui est réjouissante.
Fabienne Pascaud – Télérama – Lire l’article intégral ici
Une adaptation inspirée et audacieuse de Jérémie Le Louët et de sa Compagnie des Dramaticules.
Etienne Sorin – Le Figaro
Nos six acteurs maîtrisent avec brio les changements de rôles et de jeu. Le duo formé par Jérémie Le Louët (Don Quichotte) et Julien Buchy (Sancho Panza) est détonant.
Philippe Chevilley – Les Echos
Drôlement culotté et sacrement intelligent ! Don Quichotte par Jérémie Le Louët, c’est une formidable machine théâtrale.
Denis Sanglard – Unfauteuilpourlorchestre.com
La mise en scène est paradoxale. A la fois classique, moderne, audacieuse, désordonnée, tour à tour burlesque et grave, comme si le héros, dans sa déconfiture, proposait autre chose de plus grand, de plus généreux que la réussite et les honneurs, un réel plus réel, un vrai plus vrai.
Claude Kraif – Revue-Spectacles.com
Production Compagnie des Dramaticules. Coproduction Châteaux de la Drôme, Théâtre de Châtillon, Théâtre de la Madeleine – scène conventionnée / Troyes, Centre culturel des Portes de l’Essonne, Théâtre Jean Vilar / Vitry-sur-Seine, Théâtre André Malraux / Chevilly-Larue. Avec le soutien du Conseil régional d’Île-de-France, des Conseils départementaux de l’Essonne et du Val-de-Marne, d’Arcadi Île-de-France et du Centre d’art et de culture / Meudon,…